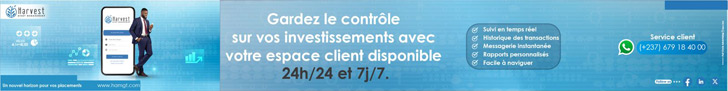Le 22 juillet, l’administration Trump a annoncé un nouveau retrait des États-Unis de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). Ce départ, effectif au 31 décembre 2026, constituera la troisième rupture américaine avec l’organisation après 1984 et 2018.
Washington accuse l’Unesco de biais politique, notamment envers Israël, et de promouvoir des valeurs « idéologiques » contraires aux intérêts américains. L’administration américaine critique la reconnaissance de la Palestine comme État membre, les programmes liés à la diversité, ainsi qu’une supposée mainmise croissante de la Chine sur l’orientation stratégique de l’organisation. « L’Unesco est devenue une tribune pour des agendas politiques hostiles à nos intérêts et nos valeurs », a déclaré un conseiller du Département d’État.
Sur le plan budgétaire, les États-Unis contribuaient à environ 8 % du financement de l’Unesco, mais leur influence normative y restait forte. Leur retrait créera un vide géopolitique, notamment sur les questions liées à la liberté de la presse, à l’intelligence artificielle, à la mémoire historique ou à l’éducation numérique.
Pour nombre d’analystes, ce départ illustre un repli stratégique du multilatéralisme américain et ouvre la voie à une montée en puissance accrue de la Chine dans les forums internationaux.