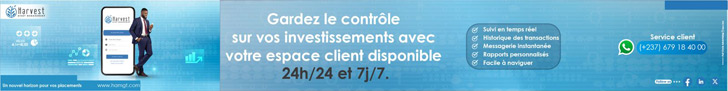Côte d’Ivoire : l’exclusion de Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo de la présidentielle relance les tensions politiques
Le Conseil constitutionnel ivoirien a invalidé le 8 septembre les candidatures de l’ancien dirigeant de Credit Suisse, Tidjane Thiam, et de l’ex-président Laurent Gbagbo, à la présidentielle. Simone Gbagbo, ex-première dame, a en revanche été retenue. Le président sortant Alassane Ouattara, candidat à un quatrième mandat, reste le grand favori.
Cinq candidatures sur soixante déposées pour l’élection présidentielle prévue le mois prochain. Ont été validées. Parmi elles figure celle du président sortant Alassane Ouattara, 83 ans, qui avait confirmé en juillet son intention de briguer un quatrième mandat à la tête du premier producteur mondial de cacao.
L’annonce a toutefois suscité des tensions, avec l’invalidation des candidatures de deux figures majeures de la scène politique : Tidjane Thiam, représentant du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), et l’ancien chef de l’État Laurent Gbagbo. À l’inverse, Simone Gbagbo, ex-première dame et ancienne détenue politique, pourra se présenter.
Tidjane Thiam, ancien PDG de Credit Suisse, était pressenti comme le principal candidat de l’opposition. Mais sa radiation de la liste électorale avait été prononcée dès avril par la justice, au motif qu’il détenait encore la nationalité française au moment de son inscription.
La loi ivoirienne exige que tout candidat soit exclusivement de nationalité ivoirienne. Thiam a dénoncé une élection qui risque de se transformer en « couronnement » pour Ouattara, jugeant qu’un quatrième mandat serait « inconstitutionnel ». Laurent Gbagbo, quant à lui, reste une figure clivante.
Sa contestation des résultats de l’élection de 2010 avait plongé la Côte d’Ivoire dans une crise post-électorale qui a fait plus de 3 000 morts, avant son arrestation avec Simone Gbagbo à Abidjan. Jugé à La Haye pour crimes contre l’humanité, il a été acquitté, tandis que son ex-épouse a été condamnée en Côte d’Ivoire pour atteinte à la sûreté de l’État, avant de bénéficier d’une amnistie présidentielle en 2018.
Si le camp Ouattara met en avant sa volonté d’organiser un scrutin pacifique, plusieurs analystes estiment que la faiblesse du champ électoral face à un président sortant expérimenté pourrait accentuer les tensions.
La campagne officielle doit s’ouvrir le 10 octobre, dans un climat où la question de l’éligibilité continue de peser lourdement sur la stabilité politique.
L’Union africaine et les Caraïbes exigent des réparations face à l’héritage du colonialisme
L’Union africaine réclame, aux côtés des pays caribéens, des réparations pour les crimes de la colonisation et de l’esclavage. Les demandes portent sur des compensations financières, la restitution d’artefacts, des excuses officielles et une réponse au défi climatique, malgré le rejet répété des anciennes puissances coloniales.
La rencontre, qui a réuni des responsables africains et caribéens, a mis en avant une vision commune : obtenir justice réparatrice et reconnaissance du passé. Le président de la Commission de l’UA a souligné que ce combat devrait « honorer les ancêtres, élever les générations futures et revendiquer une destinée partagée dans la liberté et l’unité ».
Les demandes africaines s’ajouteront à celles de la communauté caribéenne (Caricom), qui milite depuis plus de dix ans pour des réparations évaluées en milliers de milliards. Leur plan inclut des excuses formelles, l’annulation d’une partie de la dette, ainsi qu’un soutien accru en matière de développement économique et éducatif.
Les anciennes puissances concernées - dont le Royaume-Uni, la France, le Portugal, l’Espagne, l’Allemagne et la Belgique - pourraient être sollicitées non seulement au titre de la traite transatlantique, mais aussi pour les effets durables du colonialisme.
Ces réparations pourraient prendre des formes variées : réformes économiques internationales, restitution d’objets culturels spoliés, compensations liées au changement climatique. Les demandes de réparations ont été à plusieurs reprises rejetées par les Premiers ministres britanniques successifs, y compris Keir Starmer, qui a repoussé les efforts du Commonwealth visant à obtenir un engagement en matière de paiements réparateurs.
La France et d’autres anciennes puissances esclavagistes ont également écarté ces revendications. Face à ces refus persistants, certains États caribéens ont décidé de changer de stratégie : plutôt que de cibler uniquement les gouvernements, ils adressent désormais leurs revendications à des institutions financières ou culturelles, jugées plus ouvertes au dialogue.
Le débat met également en lumière la part de responsabilité de certaines monarchies africaines, qui avaient profité de la traite en vendant des captifs aux Européens. Toutefois, le quotidien britannique note qu’aujourd’hui, c’est sur l’impact global et persistant du système colonial que se concentrent les revendications des pays touchés par le colonialisme.
Source RT