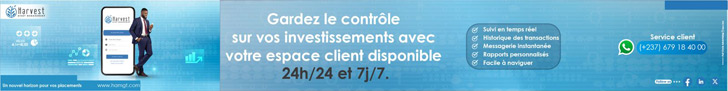L’annonce de l’annulation du visa américain de Wole Soyinka, prix Nobel de littérature et monument de la pensée africaine, résonne comme un symbole du rapport ambigu que les États-Unis entretiennent avec les intellectuels du Sud.
Derrière le geste administratif, apparemment banal, se cache une décision politique et idéologique : réduire au silence une voix noire indépendante, critique et libre. À 91 ans, Wole Soyinka n’a plus rien à prouver. Premier Africain à recevoir le Nobel de littérature en 1986, il est reconnu dans le monde entier pour sa défense de la démocratie, sa lutte contre les dictatures africaines et sa dénonciation du racisme sous toutes ses formes. L’homme qui s’est opposé à la tyrannie militaire au Nigeria n’a jamais cessé de prôner une Afrique digne et souveraine. En annulant son visa, Washington ne vise pas seulement un individu : il humilie symboliquement tout un continent qui ose encore penser par lui-même.
Ce n’est pas la première fois que les États-Unis, sous couvert de souveraineté consulaire, manifestent une certaines "arrogance" diplomatique envers les nations africaines. Le cas Soyinka rappelle celui d’autres intellectuels ou militants dont les déplacements ont été restreints pour leurs opinions, souvent critiques à l’égard de la politique étrangère américaine. Depuis l’ère Trump, la suspicion envers les intellectuels étrangers, surtout africains, s’est accentuée - comme si la pensée critique venue du Sud constituait une menace. Le paradoxe est flagrant : ce pays qui se présente comme le champion de la liberté d’expression refuse un visa à un écrivain dont l’œuvre incarne justement cette liberté.
Le message est clair : la voix africaine est tolérée tant qu’elle célèbre l’Occident, mais devient indésirable dès qu’elle questionne son hypocrisie. Pour l’Afrique, Wole Soyinka n’est pas seulement un écrivain. Il est la conscience du continent, un rappel que la dignité ne s’achète pas et que la pensée libre demeure le dernier bastion de souveraineté. En annulant son visa, les États-Unis ont, involontairement, renforcé cette vérité : la liberté ne dépend pas d’un tampon sur un passeport, mais du courage de dire non à l’injustice - d’où qu’elle vienne.