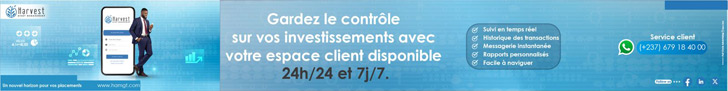Le président français Emmanuel Macron s’est rendu le vendredi 19 mai sur la base de Gao au Mali, pour donner une nouvelle dimension à l’engagement militaire de la France, présente depuis quatre ans pour lutter contre les djihadistes. Il s’agissait de son premier déplacement hors d’Europe.
Par cette visite intervenue moins d’une semaine après son entrée en fonctions, Emmanuel Macron voulait non seulement marquer sa détermination à poursuivre l’engagement au Sahel mais aussi l’inscrire dans une coopération renforcée avec l’Allemagne. Il entend encore compléter l’action militaire par une stratégie d’aide au développement, selon une source proche de la présidence française.
Le chef de l’Etat français était accompagné par les ministres Jean-Yves Le Drian (Europe et Affaires étrangères) et Sylvie Goulard (ministre des Armées), ainsi que par le directeur général de l’Agence française de développement (AFD) Rémy Rioux. 25 journalistes ont également fait le déplacement du Mali.
A son arrivée, le président français a été accueilli par son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, avec qui il a eu un entretien sur la lutte contre le terrorisme, le dossier sahélien, le volet politique du dossier et la difficile mise en œuvre des accords de paix de 2015. Et en sa qualité de nouveau chef des armées, Emmanuel Macron s’est adressé aux 1.600 soldats déployés sur la base de Gao (nord) dans le cadre de l’opération française Barkhane, et s’est fait présenter les différentes composantes du dispositif.
Pour l’Elysée, le choix de Gao est justifié au fait qu’il s’agit de la plus importante base des forces françaises engagées à l’extérieur.
Somme toute, le président français veut davantage que l’ex-président François Hollande (2012-2017), mettre l’accent sur la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme, avec les autres pays européens, notamment l’Allemagne, premier contributeur de la Mission des Nations unies au Mali (Minusma), selon son entourage. La France veut « une impulsion franco-allemande pour que l’Europe joue un rôle croissant dans les dossiers de sécurité et de défense, dont ceux de l’Afrique et du Sahel », précise-t-on. Cette question avait été évoquée le lundi 15 mai avec la chancelière allemande Angela Merkel.
La présence du directeur général de l’AFD aux côtés du chef de l’Etat français au Mali montrait un nouvel axe affiché par la présidence française : articuler davantage l’approche militaire avec les politiques de développement. C’est ce que demandent depuis quelque temps plusieurs organisations humanitaires, pour qui la seule approche militaire ne résoudra pas les violences secouant le Mali.
La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) par exemple, plaide pour que l’approche développement soit incluse dans la nouvelle politique de la France. La politique française en Afrique est trop « purement militaire », et doit « investir dans le secteur de la gouvernance », notamment dans « la lutte contre l’impunité » en « réorientant son aide publique vers la justice », insiste l’ONG de défense des droits de l’Homme. Elle dénonce au Mali « un niveau d’insécurité sans précédent ».
Human Rights Watch, une organisation humanitaire appelle quant à elle, Emmanuel Macron à « exhorter le président du Mali à s’attaquer frontalement aux problèmes qui ont mené à des décennies d’instabilité, notamment une faible gouvernance, une corruption endémique et les abus commis par les forces de l’ordre ».
Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, qui ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale, lancée en janvier 2013 à l’initiative de la France. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et internationales (1.600 soldats français et 12.000 soldats de la Minusma), régulièrement visées par des attaques meurtrières, malgré la signature en mai-juin 2015 d’un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes. Depuis 2015, ces assauts se sont étendus au centre et au sud du pays, où la sécurité se détériore de plus en plus.
Des sources concordantes avancent que dix-sept militaires français ont été tués au Mali depuis l’intervention Serval en janvier 2013, à laquelle a succédé en août 2014 l’opération Barkhane (4.000 hommes), étendue sur cinq pays du Sahel (Mali, Burkina-Faso, Mauritanie, Niger et Tchad).