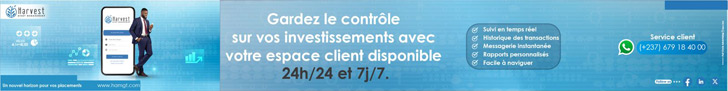Quand vous vous promenez dans les artères de Brazzaville et que vous tendez l’oreille aux causeries, le mot « crise » revient sur toutes les lèvres. Forcément, avec cette crise qui frappe de plein fouet notre économie nationale depuis quelques années, la population a dû changer ses habitudes de consommation.
L’argent se faisant rare, les priorités budgétaires des ménages ont aussi changé. S’habiller, mieux, « saper » comme en raffole le Congolais, n’est plus une priorité. Il faut d’abord songer à se nourrir, à se déplacer, à la santé et à l’éducation des enfants. Quand tous ces points prioritaires ont été réglés, l’argent qui reste peut alors aller dans les vêtements. Mais malheureusement quand on fait les calculs, il ne reste plus grand chose. Alors que fait-on ? On court dans les échoppes de seconde main communément appelées « friperie » pour se vêtir. Une chose qu’on peut affirmer est que ce phénomène est à la mode. Et il touche quasiment l’ensemble des classes sociales.
Dans les grands marchés de la ville et tout au long des avenues, les étals de friperie côtoient celles d’autres denrées. La population se bouscule pour trier les vêtements de seconde main à l’ouverture des ballots par les vendeurs. On peut y faire de très bonnes trouvailles ; des chemises à 500 FCFA, des pantalons à 1000, des robes à 2000 ou des costumes à 20 000 FCFA, quand on sait que dans un magasin de prêt-à-porter, il coûte 300 000 FCFA. Le tout en assez bon état. Après un bon nettoyage, on a même l’impression qu’il s’agit d’un vêtement neuf. Des tarifs à la portée de toutes les bourses.
Pour ceux qui se sont lancés dans ce business, les affaires sont parfois excellentes, car un ballot est vendu par les grossistes au plus bas à 50 000 FCFA et au plus cher à 200 000. Selon certains vendeurs, la friperie rapporte assez bien. Les bénéfices se situeraient entre 75 et 100% d’après eux.
Cependant, ce marché est très aléatoire. Il n’est pas donné à tout vendeur de tomber sur des vêtements de bonne qualité. Pour les détaillants, la provenance des ballots détermine la bonne ou mauvaise qualité de la marchandise. Même si les connaisseurs s’en sortent bien, ce caractère aléatoire de ce commerce décourage beaucoup de néophytes qui n’hésitent pas à abandonner l’activité, quelques jours seulement après s’être lancés.
Petite histoire de la friperie
L’histoire de la friperie a débuté en Europe, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le vieux continent étant ressorti ruiné de ce conflit, l’Amérique qui en sort, quant à elle, enrichie, entreprend un vaste mouvement de générosité à l’endroit des Européens. On verra les dons de vêtements usagés affluer vers l’Europe. Puis, le pouvoir d’achat de la population européenne s’étant amélioré, le prix des textiles ayant baissé, les vêtements usagés se sont trouvés d’autres destinations.
C’est ainsi qu’après l’Europe, les territoires africains, d’abord colonies puis Etats naissants, sont rapidement devenus un débouché intéressant pour les vêtements dont les Occidentaux ne voulaient plus. Des organisations caritatives ont commencé à collecter ces vêtements usagés, non plus forcément pour les donner aux pauvres, mais pour les vendre et dégager de petites ressources financières. Au départ, ces vêtements de seconde main étaient plutôt rejetés dans la plupart de nouveaux pays africains où naissait une industrie du textile et de l’habillement. Mais avec les dévaluations répétées des monnaies africaines, de nombreux gouvernements ont commencé à les tolérer, pour répondre à la demande des ménages à faible pouvoir d’achat.
Face à ce besoin, il y a eu une offre chinoise. Mais les vêtements provenant de Chine, bien que neufs, étaient parfois de mauvaise qualité, ce qui a donné un nouvel élan aux habits de seconde main en provenance d’Europe et d’Amérique, parfois plus solides et plus durables.
Le plaisir d’être son propre patron
La friperie demeure une activité informelle. Elle est tenue de façon générale par les femmes, les jeunes diplômés sans emploi, mais aussi par des fonctionnaires reconvertis dans les affaires. Si de nombreuses personnes, notamment les jeunes s’y lancent, c’est simplement parce qu’elle ne nécessite aucune formation particulière. Il suffit d’avoir un petit fonds de commerce pour lancer son business. Certains estiment qu’ils s’en sortent plutôt bien et sont fiers d’exercer une activité économique dans laquelle ils se sentent indépendants. Le sentiment d’être son propre patron, de n’avoir de compte à rendre à personne, d’être totalement indépendant et même de gagner un peu plus qu’un salaire de la Fonction publique, sont ceux qui animent de manière globale ceux qui se lancent dans ce business.
L’Afrique peut-elle se passer de la friperie ?
Plusieurs critiques n’hésitent pas à dire haut et fort que l’Afrique subsaharienne est devenue un défilé de mode géant de vêtements de seconde main. De nombreuses voix s’élèvent pour critiquer cette forme de commerce. À la question de savoir si l’Afrique peut se passer de la friperie, la réponse n’est pas évidente et les arbitrages à faire par les gouvernements sont assez complexes. Bien des personnes qui travaillent depuis longtemps dans ce secteur continuent de se persuader que ce n’est qu’un job provisoire, n’empêche que depuis des années, ils parviennent à en vivre et à nourrir des familles.
L’autre réalité est que, tant que se poursuivra la surconsommation de la mode dans un Occident qui a établi des filières de rentabilité solides, combattre la friperie dans des régions peu développées comme l’Afrique sera difficile. Le Rwanda, avec sa relance de l’industrie de l’habillement, constitue un espoir, et une combinaison de ses efforts, avec ceux du Nigeria, du Maroc, de l’Ethiopie ou encore de l’Afrique du Sud, pourrait ouvrir de nouvelles perspectives aux pays africains. Mais il faut reconnaître que le chemin à parcourir sera long. Les vêtements de seconde main sont pour la plupart de bonne qualité et ils répondent à un besoin fondamental de l’être humain : se protéger et se vêtir. Et tant que le pouvoir d’achat de la majorité de la population africaine restera faible, la friperie aura encore de beaux jours devant elle.