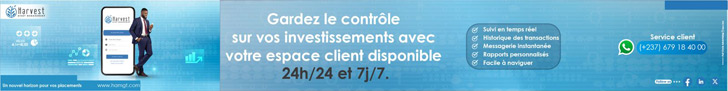Il y a vingt-neuf ans, nous quittait François Luambo Makiadi, connu sous les noms de Franco Luambo ou plus simplement de Franco.
 Né le 6 juillet 1938 à Sona-Bata (Congo belge), actuel Bas-Congo, il est mort le 12 octobre 1989 à Mont-Godinne, en Belgique. Artiste talentueux, ce griot africain a forcé la considération du continent et d’une partie de l’univers. Il est un musicien authentique, libertaire et patriote. Son engagement doit tout à son art et à son peuple.
Né le 6 juillet 1938 à Sona-Bata (Congo belge), actuel Bas-Congo, il est mort le 12 octobre 1989 à Mont-Godinne, en Belgique. Artiste talentueux, ce griot africain a forcé la considération du continent et d’une partie de l’univers. Il est un musicien authentique, libertaire et patriote. Son engagement doit tout à son art et à son peuple.
En dehors de l’authenticité de son art et de l’amour de la nation, au sens noble du terme, il n’a épargné personne. Baudelaire dirait : « comme l’alabatros, il a les pieds ici et les yeux ailleurs …». Effectivement, Franco de Mi Amor fascinait et fascine toujours parce qu’il reste insaisissable. Qui peut affirmer le comprendre dans sa totalité ? Cet artiste exceptionnel, paradoxal et contradictoire, mû par la fureur de réussir et donc de prendre sa revanche sur une enfance difficile, n’avait qu’une seule religion : « être soi et rien d’autre ». Son sourire omniprésent avait quelque chose d’énigmatique et de mystérieux.
Luambo Makiadi a décidé d’être définitivement artiste à l’âge de 18 ans, en choisissant la carrière musicale. Il en accepte les conditions et en revêt les symboles. Ce qui est fort important car, à l’époque coloniale pour se décider d’embrasser ce domaine, on devait se mettre en porte-à-faux avec sa famille ou alors évoluer dans un milieu qui a rompu définitivement avec l’école.
À cette époque, les meilleurs artistes étaient assimilés à des païens, des gens dangereux dont, à tort ou à raison, les nouveaux maîtres craignaient qu’ils ne puissent cristalliser la conscience populaire à travers leurs créations et sacraliser ainsi la cause des révoltes et des séditions. D’où, il a fallu s’emparer de «l’art indigène», dans toutes les formes spontanées de sa manifestation, faire semblant de la détruire mais en réalité l’emporter en Occident et ainsi briser l’unité du peuple pour affaiblir la résistance à la pénétration coloniale, ravaler la civilisation nègre à sa moindre expression pour mieux inoculer le complexe de supériorité de l’Occident. L’artiste ainsi isolé et ébranlé pouvait être embrigadé dans les forces armées, les travaux publics ou autres activités sans le moindre rapport avec son talent.
Luambo conçoit et élabore de nouvelles formes musicales
Pour avoir évolué dans la rue et être resté en contact permanent avec la main d’œuvre des sociétés industrielles, c’est-à-dire les détribalisés et les extra-coutumiers qui peuplaient véritablement la ville de Léo, Luambo va lentement forger un style de musique qui n’emprunte guère aux formes euro-américaines et qui rappellent l’accompagnement traditionnel. C’est une musique qui, sans être pauvre, ne met pas trop l’accent sur la grande recherche qui fait les musiques très intellectuelles et très distinguées. La sienne doit être dansante et mettre en valeur avant tout l’animation, le rythme et le message qui en constituent la raison.
De même la vigueur, la vivacité et l’inventivité de Luambo trouveront un terrain fertile dans le lingala qui est la langue de prédilection dans laquelle il s’exprime et qu’il manie avec aisance, langue qu’il contribuera à enrichir en forgeant des mots et des expressions irrésistibles qui figurent aujourd’hui en bonne place dans le vocabulaire usuel.
Luambo, sociologue
Luambo a chanté la société et est demeuré prudent dans son engagement politique. Il a contribué à marquer du sceau du romantisme la période précédant l’indépendance. Franco a chanté l’identité nègre. Il a surpris le monde avec quelques chansons bien connues. L’une d’elle est intitulée en français "Je suis nègre". Il a dénoncé la spoliation des terres dans "Likambo ya mabele". Luambo Makiadi a raillé le nouveau riche parvenu dans "Nani apedalaki te", une diatribe contre le nouveau riche, tout comme il a dénoncé la dégradation de l’économie dans "Biloko bimati talo na Kinshasa".
Ainsi, il a été semblable à Balzac et Molière. La grande ressemblance avec Balzac vient de l’éclairage cru, réaliste et naturel de ses tableaux. Balzac étant le chroniqueur des quotidiennetés de son époque, celui qui espionnait les ouvriers rentrant de l’usine après une journée exténuante de labeur pour en faire des sujets de ses romans.
Avec Molière, Luambo partage la profondeur de l’observation et la vérité du style par lesquelles on arrive à la comédie des mœurs, c’est-à-dire la raillerie et la causticité piquante agrémentant l’œuvre de démolition des gens superficiels et faussement cultivés qui se croient arrivés au sommet.