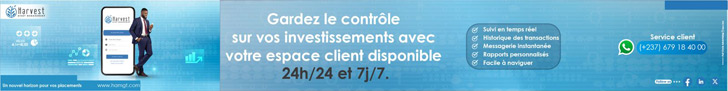Originaire des plateaux batékés, le colonel à la retraite, qui ne porte pas de marques particulières sur le visage, explique avec respect et fierté ce que représentaient les balafres. Regard sur un symbole de beauté désormais passé de mode
Les Dépêches de Brazzaville : Quels sont les départements qui étaient directement concernés par ces signes ?
Gérard Ebami Sala : Principalement le département des Plateaux. L’ethnie téké présentait différentes scarifications selon que l’on venait des Plateaux « koukouya », de Lékana, de chez les Boma (Ngo) ou des terres Ndzikou qui étaient majoritaires à Djambala. C’est principalement dans ces zones que l’on retrouvait des marquages plus fins. Les balafres incarnaient la beauté de cette région du Congo. Il existe certes d’autres Tékés, dans la Cuvette, dans le Pool (les Oumou), dans la Bouenza et la Lékoumou. Mais, c’est dans les Plateaux en particulier que l’on retrouvait des Tékés balafrés. Ce n’est pas forcément ceux de pure souche, comme on a laissé entendre autrefois, mais ces signes distinctifs montraient bien que l’on était originaire des Plateaux si bien sûr on en portait.
LDB : On retrouve pourtant des Tékés en dehors de nos frontières ? Sont-ils concernés?
GES : Le royaume téké s’étendait bien au-delà du Congo, en RDC et au Gabon. Cependant, les balafrés particulièrement, on les retrouvait au Congo, dans les Plateaux.
LDB : Qu’incarnaient ces scarifications ?
GES : Les marquages signifiaient la richesse. Nous qui n’en en avions pas, on disait de nous que nos joues ressemblaient à la cuisse d’un pygmée (aujourd’hui peuple autochtone). Pour nous défendre, nous disions que ceux qui avaient des balafres cachaient par là une certaine laideur (rires). Parce que porter des balafres, c’est beau d’en porter tout simplement.
LDB : Pourtant vous, particulièrement, vous ne portez pas de balafres ?
GES : Plusieurs raisons expliquent ce fait. Dans mon cas, je suis rentré à l’âge de treize ans à l’école Général-Leclerc de Brazzaville. Donc loin de mes parents. Pendant mes vacances scolaires, je passais mon temps avec mes amis à visiter d’autres régions. Je ne suis retourné au village que deux fois entre la sixième et la terminale. C’est tout dire ! C’est une des raisons, mais mon père qui travaillait à l’époque avec des colons n’avait pas jugé nécessaire que je porte moi aussi des balafres. Je crois que l’approche de l’homme blanc avait changé sa vision à cette époque-là. D’ailleurs, dans notre lignée, c’est la première fille qui en porte car on privilégiait les jeunes filles à cause du mariage.
LDB : Que pensez-vous de la scarification ? Quel âge devaient avoir les enfants que l’on scarifiait ?
GES : Dans l’art de la scarification, ce que j’admire ce sont les personnes très ingénieuses qui les pratiquaient. Voyez comment ces marquages étaient faites, avec précision et des lignes équidistantes. Le tout avec quel matériel ? Mais le procédé de la scarification n’est pas loin de celui de la circoncision. On neutralisait l’enfant de moins dix ans et sans anesthésiant. Parmi mes sœurs, il y en a une qui a souhaité se faire marquer à l’âge adulte. Des cas de ce genre ont forcément existé. Le remède pour cicatriser les plaies était aussi tout simple. Il était fait de feuilles de bananiers passées légèrement au feu. Cela marche aussi pour d’autres types de plaies. Simplement incroyable !
LDB : On sent que cette culture vous a marqué. Qu’avez-vous fait pour la défendre ?
GES : Je suis fier de ma culture. J’ai épousé une femme qui porte des balafres. Dieu m’a exaucé dans ce sens. (Rires)
LDB : L’époque des balafres est-elle révolue ? Le prenez-vous en mal ?
GES : C’est une culture qui a marqué son temps et comme beaucoup d’autres apports culturels, elle tend à disparaître. La scarification est interdite de nos jours, et l’on peut comprendre. Autres temps, autres mœurs ! C'est à nous de faire connaître aux autres cette richesse parce que, quelles que soient les circonstances, nous y sommes attachés. Avec ou sans marques. C’est un lien que je souhaite conserver. C’est ma richesse.